«Un jour, un ministre me remet 500 000 FCFA comme argent de transport. Je les lui ai remis en disant que cet argent était bon pour nourrir son chien » ; « J’ai également refusé 300 000 FCFA comme ça» ; « Moi je n’ai jamais pris 10 000 FCFA de perdiem après un événement depuis que je pratique ce métier ».
J’ai recueilli ces riches témoignages pendant les obsèques du doyen Jean-Batispte Sipa. Au-delà de la douleur qui nous rongeait le week-end passé, après la disparition de cette bibliothèque, c’était une occasion pour nous jeunes de la plume, de rencontrer ceux qui ont écrit l’histoire du journalisme au Cameroun.
En toute humilité, ces doyens nous ouvrent leurs bras, leurs cœurs, les langues se délient. Autour d’un plateau d’arachides, on dialogue comme des vieux potes en sirotant un jus, une bière, ou tout simplement une bouteille d’eau minérale . Des anecdotes pleuvent, des confidences sont faites, les secrets sont dehors.
J’apprends les petits secrets de la précarité grandissante dans l’univers médiatique camerounais. Elle (précarité) puise ses origines dans la vieille école. Celle des premiers entrepreneurs de la presse privée. Ceux-ci ont lutté et obtenu la liberté de la presse. Une belle victoire qui restera graver dans les anales pour l’éternité. Un directeur de publication, un compagnon de lutte de Pius Njawe, le fondateur du quotidien « Le Messager », nous avoue que la presse était mieux avant. A l’époque, le champagne coulait à gogo, les cigares, les meufs, ils avaient tout pour construire un univers médiatique de rêve, solide, avec les soutiens financier et matériel qui provenaient des institutions internationales, des particuliers, et des Etats, pour pérenniser la lutte pour la liberté d’expression et la démocratie au Cameroun.
Les plumes étaient bien limées pour la cause. On dénonçait et condamnait avec la dernière énergie l’administration. C’était l’époque formidable. Mais le model économique ne suivait pas, malheureusement. « Quand j’allais visiter une rédaction dans un pays étranger, quand je voyais dans quelle villa vivaient mes confrères ailleurs, j’étais révolté », raconte un directeur de publication de Douala.
Plus loin, il nous explique qu’ils ne pouvaient pas construire des immeubles avec les multiples dons de l’époque, au risque de ne plus avoir les financements des institutions internationales. La technique consistait donc à montrer aux bailleurs de fonds que le pays se porte mal, que la population croupit dans la misère totale. Ceci a renforcé le regard d’infériorité que nous avons sur nous-mêmes, sur nos institutions et sur notre pays. Je peux me tromper. Mais je pense que si le pays était moins développé à l’époque, cette stratégie des premiers promoteurs de médias consistait essentiellement à garantir leurs enveloppes auprès des bailleurs de fonds.
Cela signifie en clair que certains de ceux qui dénoncent le pouvoir en place n’ont jamais aimé ce pays. Ils le font pour des objectifs bien précis. Avec l’avènement des Organisations non gouvernementale (Ong) qui pullulent dans nos villes, et la multiplication de plusieurs organes de presse, qui jouent presque le même rôle, leur pactole a pris un coup. Cela se fait ressentir dans ces rédactions, même si le train de vie de certains promoteurs est resté intacts, loin des caméras.
Les plus intelligents se sont construit des villas privées. Et les maisons de presse alors ? Ils louent quelques pièces et y maintiennent de pauvres jeunes journalistes dans une misère sans pareil, pour continuer à mener le même combat du vendre. Et les Camerounais qui nous suivent et nous lisent au quotidien alors ? Qu’est-ce que nous leur inculquons comme richesse? La misère et la précarité à longueur de journée. Qu’ils sont nostalgiques, nos vieux !
Didier Ndengue









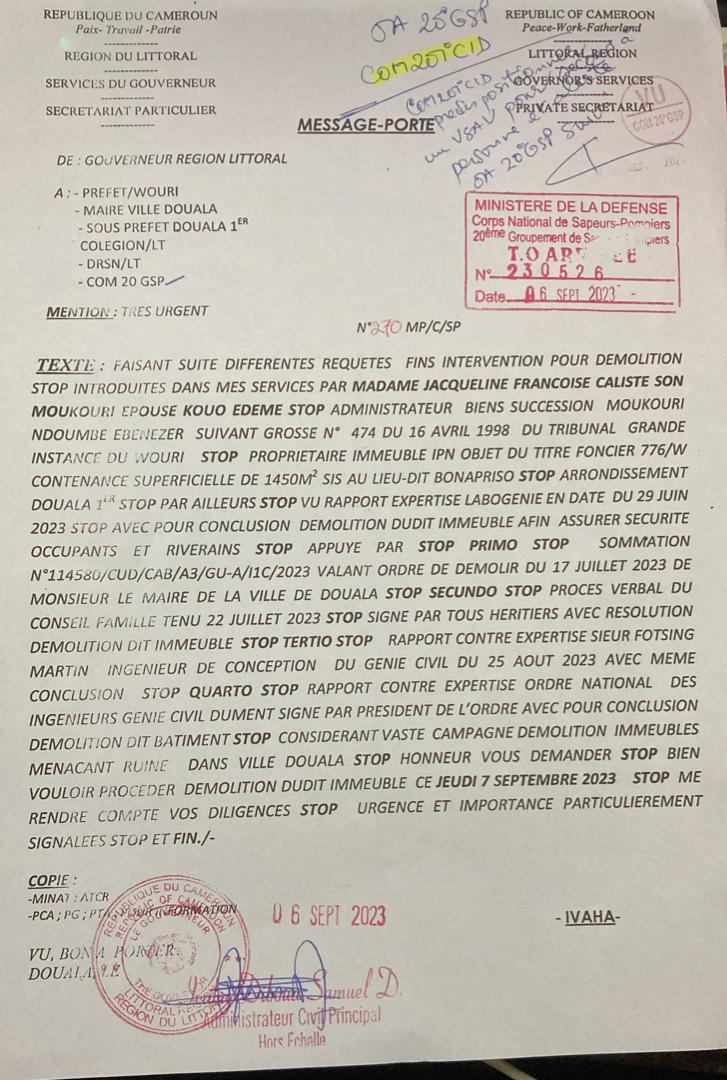


Comments